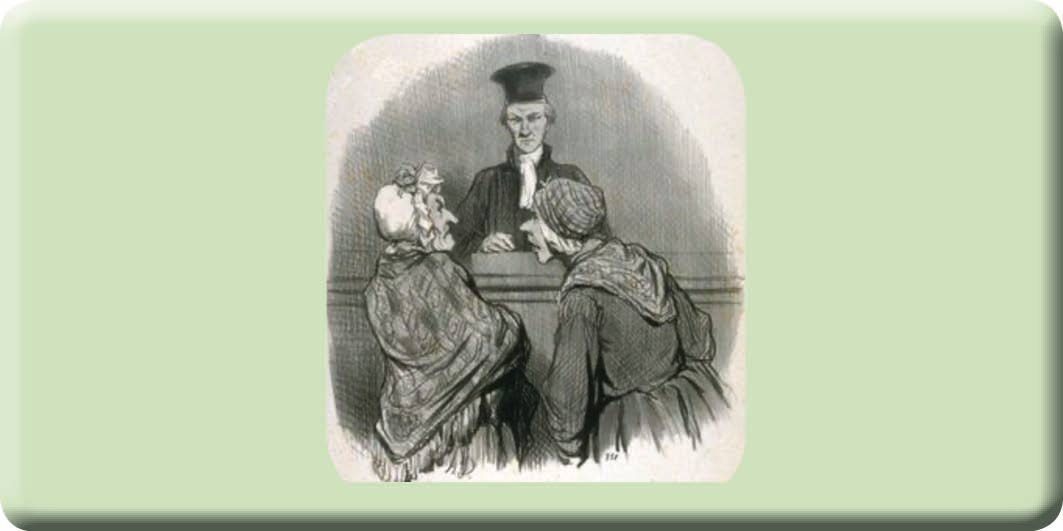Le vin à l’époque gauloise
Si les premières plantations de vigne en Gaule ne semblent pas, en l’état actuel des connaissances, antérieures au Ier ou IIe siècle de notre ère, avant le Haut-Empire, il y avait pourtant déjà du vin qui circulait dans notre région, celui-ci étant importé essentiellement depuis les rivages de la mer tyrrhénienne. En effet, les gaulois appréciaient ce breuvage, comme le rapportent les auteurs antiques. Vercingétorix, chef du peuple Arverne, devait être un grand amateur de vin, car il a été jusqu’à faire figurer sur les monnaies à son effigie, une amphore, contenant vinaire caractéristique de cette période et dont le volume pouvait avoisiner 20 à 30 litres. Les découvertes d’amphores sur les sites régionaux ne sont pas si rares, mais c’est surtout dans les agglomérations gauloises que l’on en retrouve le plus, comme à Corent (Puy-de-Dôme), où le responsable des recherches menées sur ce site, Matthieu Poux, estime que près de 100 000 amphores de vin y auraient été consommées.
Dans l’Allier, les découvertes d’amphores sont moins nombreuses, et l’exemplaire de Châtel-de-Neuvre, récemment acquis par le musée de la vigne de Saint-Pourçain, est remarquable. En effet, le récipient est presque entier, ce qui n’est pas si courant pour des vestiges de cette nature, ceux-ci étant très souvent retrouvés à l’état de fragments. Cette amphore, de type Dressel IA ou IB, datable du IIe ou Ier siècle avant notre ère, a été découverte fortuitement, en 1955, à l’occasion de la construction d’une dépendance agricole (fig. 1). De fait, on ne dispose d’aucune information sur le site d’où elle provient. Néanmoins, il semble probable que les lieux aient été occupé par un établissement rural aristocratique, implantation susceptible de receler des amphores en quantité relativement importante.
La vigne et le vin à l’époque gallo-romaine
Si la documentation textuelle est assez rare pour cette période, en revanche, les représentations en lien avec ce thème sont extrêmement nombreuses. Ainsi, on en retrouve sur des objets du quotidien, comme sur les céramiques sigillées (fig. 2) ou la vaisselle en verre, mais aussi sur les mosaïques. Dans le domaine de la statuaire, on pense forcément au dieu Bacchus souvent représenté avec une grappe de raisins dans une main et une corne à boire dans l’autre, comme l’exemplaire découvert anciennement à Vichy (fig. 3).
En Auvergne, les preuves formelles d’une production vinicole antique sont encore discutées. L’un des rares établissements ruraux ayant livré des vestiges bâtis susceptibles d’être liés à ce type d’activité est celui de Maréchal à Romagnat (Puy-de-Dôme), fouillé en 1992, sur le tracé du contournement sud de Clermont-Ferrand. Parmi les bâtiments mis au jour dans la partie agricole de cette villa, une construction rectangulaire de plus de 100 m2 présente les caractéristiques d’un chai avec, dans sa partie occidentale, des aménagements (bassins et pressoir) susceptibles d’avoir servi à la production de vin et/ou d’huile.
Par ailleurs, en Auvergne, il existait au début de notre ère une production d’amphores qui pourraient bien avoir été vouées à la commercialisation du vin local. Un certain nombre d’autres indices (identification de pollen de vigne cultivée, découverte de restes de raisins, d’outillage adapté au travail de la vigne, ou présence de fosses de plantation) invitent à penser que l’origine du vignoble auvergnat se situerait bien dans le courant du Haut-Empire, au Ier ou IIe siècle de notre ère.
Dans les environs de Montluçon, des photographies aériennes ont permis de repérer des alignements de fosses rectangulaires qui témoignent d’anciennes cultures, peut-être de vigne (fig. 4). Mais en l’absence de fouille, il est impossible, d’une part d’en préciser la datation, et d’autre part d’être vraiment certain qu’il s’agit bien de ce type de plantations.